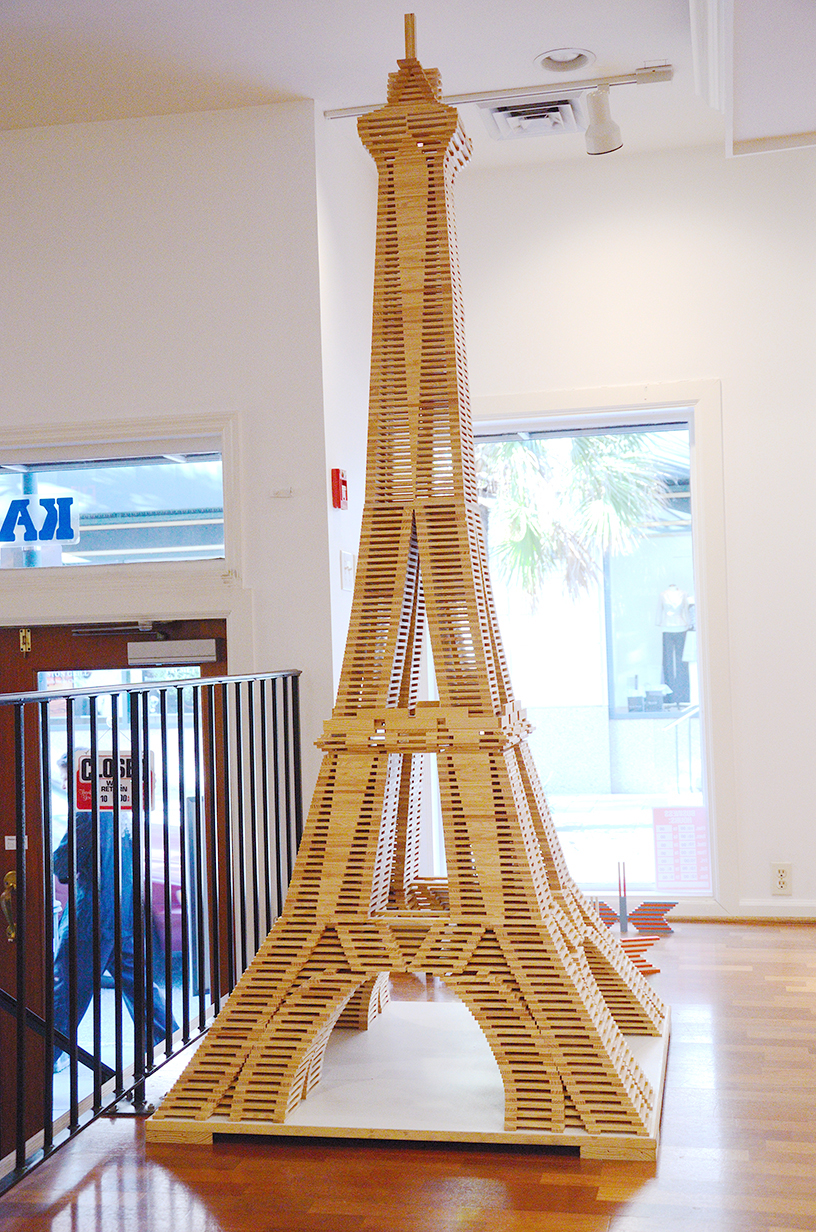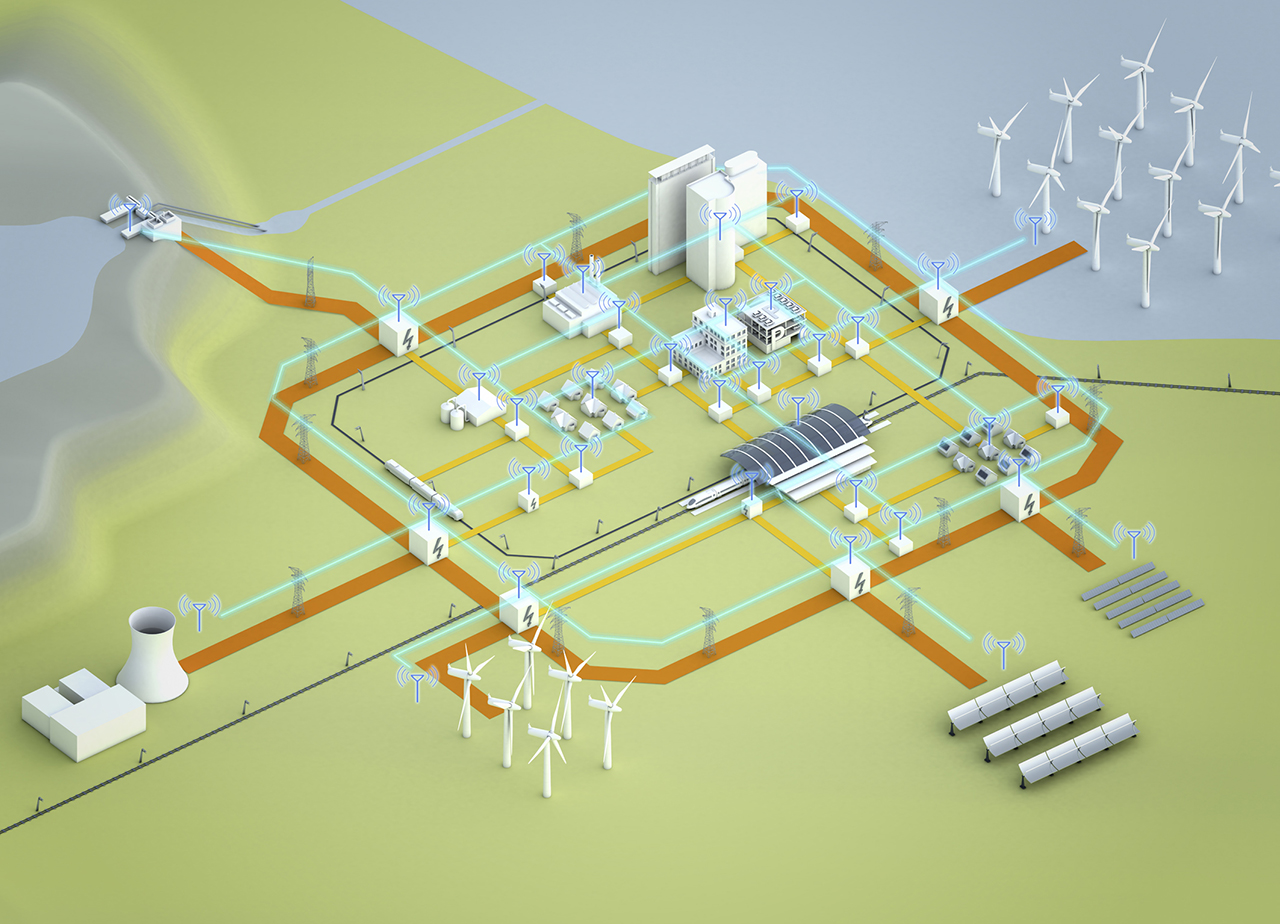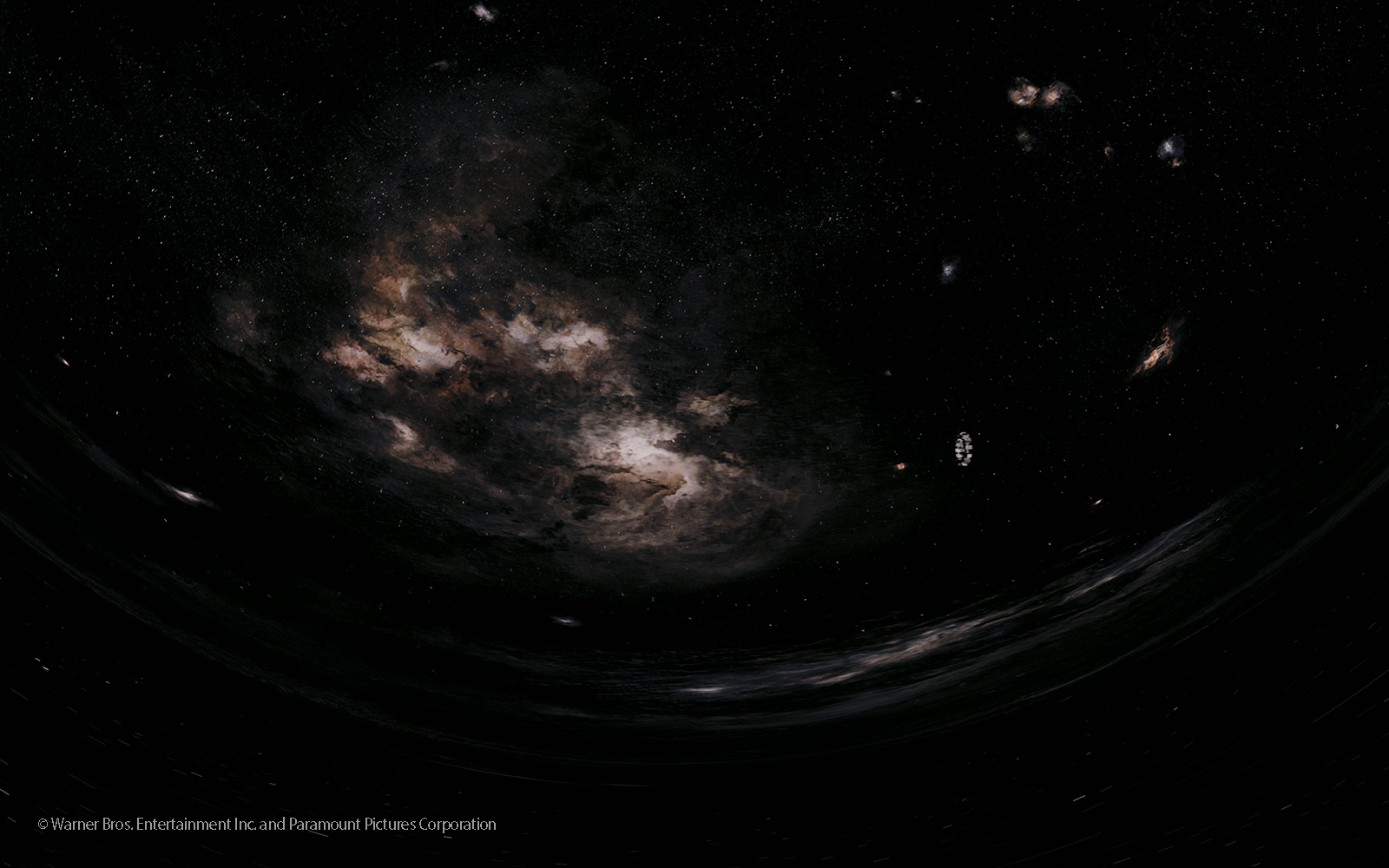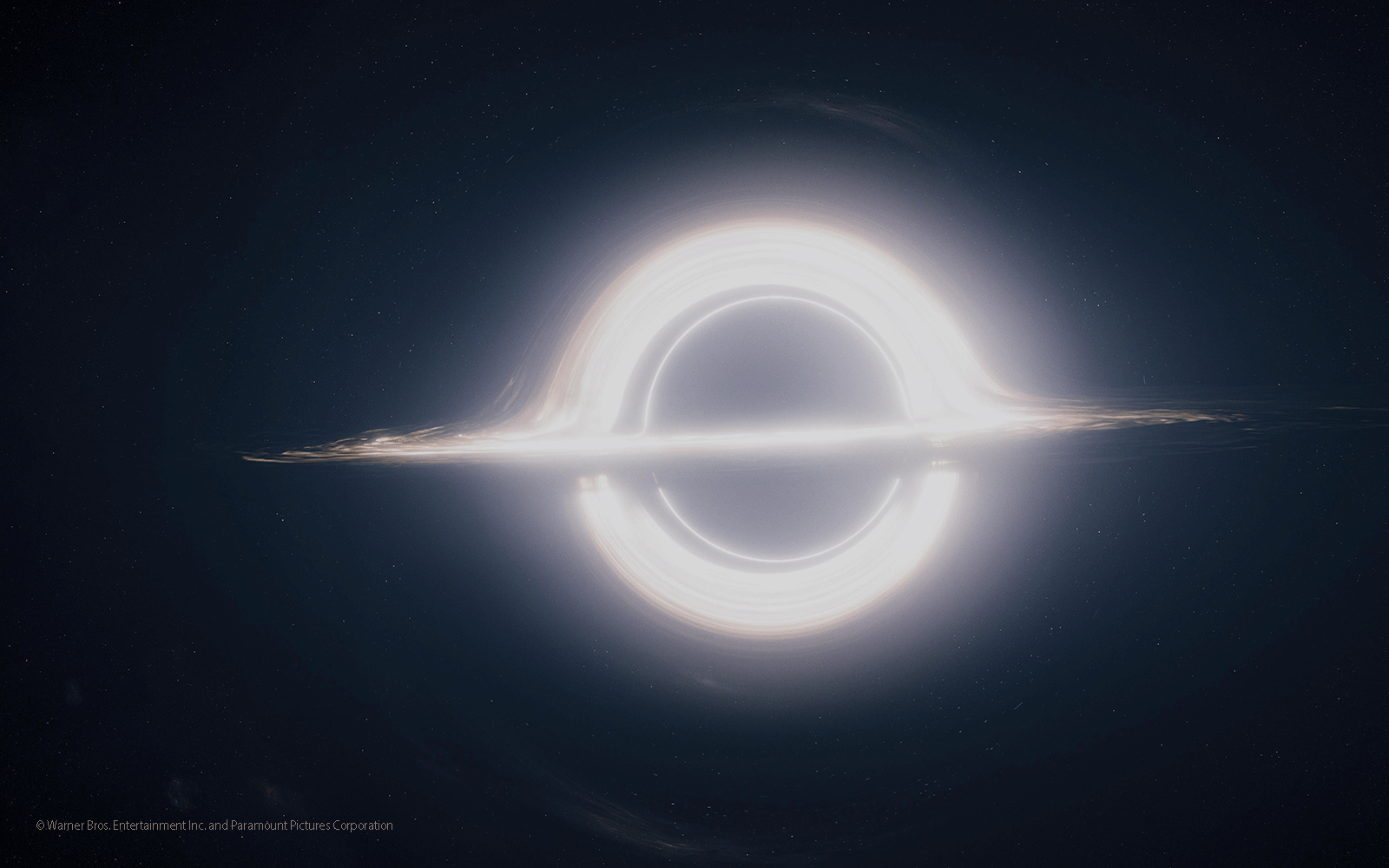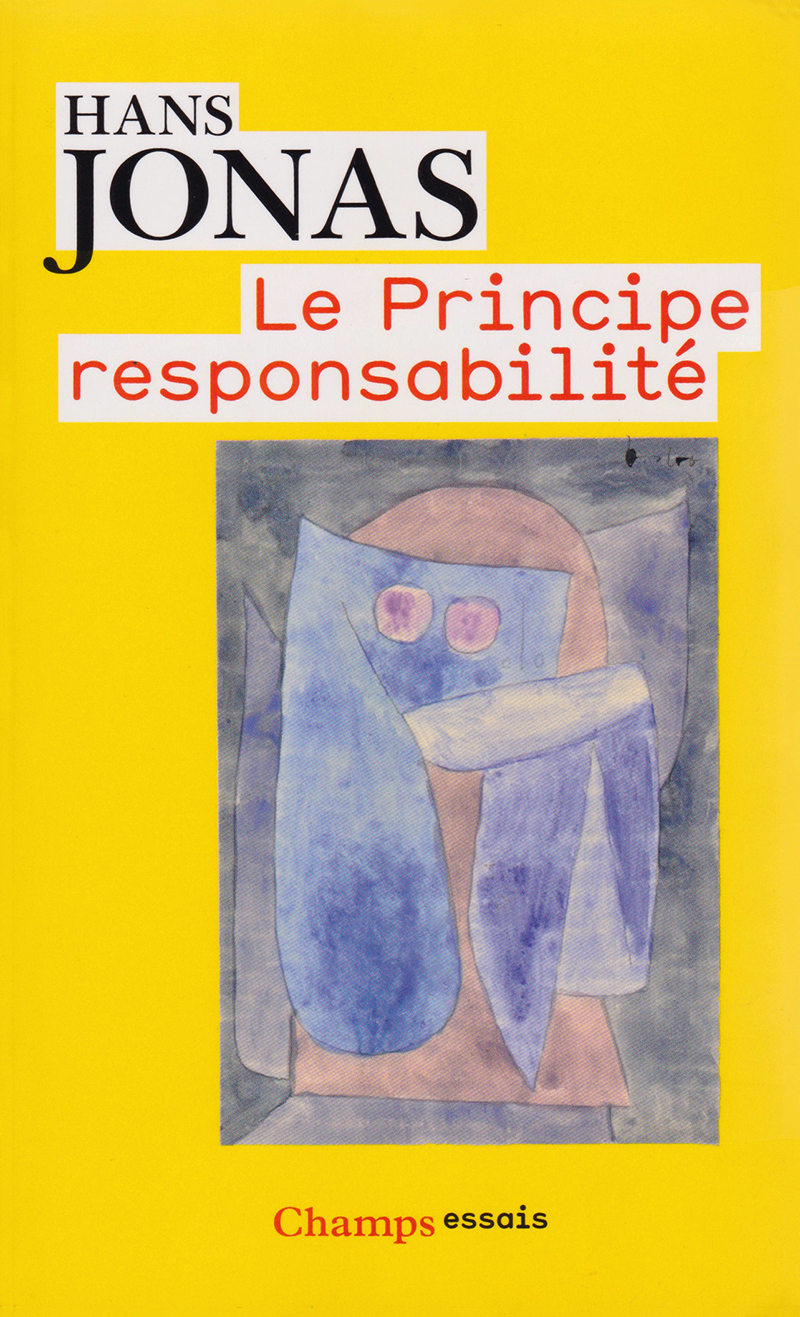B. La guerre des mondes d’Orson Welles, qu’entend-on par là ?
Introduction
169L’exemple de la réception de La guerre des mondes d’Orson Welles retransmet de façon criante le ton apocalyptique. Il se laisse entendre dans des scènes de mystification et de démystification qui s’enchaînent sur fond de conflits d’intérêts. Pour exposer cela, je m’appuierai notamment sur le travail du sociologue Pierre Lagrange qui décortique ce mythe dans son ouvrage la guerre des mondes a-t-elle eu lieu ? J’utilise donc cet épisode en tant qu’illustration, pour entendre le ton apocalyptique, dans la pièce elle-même, dans la voix d’Orson Welles, mais aussi et surtout dans les voix des experts et des commentateurs de l’époque. Plus précisément, mon but est de rendre tangibles deux caractéristiques essentielles de ce ton pointées par Jacques Derrida : la fiction du ton, et la confusion entre la voix de la raison et la voix de l’oracle.
1. Le ton apocalyptique d’Orson Welles
170Orson Welles, est une personnalité aux multiples facettes, mais, ce qui m’intéresse est avant tout son activité dans le milieu du théâtre. En tant qu’acteur et metteur en scène, il s’occupe du jeu de l’acteur, donc de sa capacité à dire un texte sur le bon ton. C’est un lieu commun, les acteurs opèrent par leur jeu une fiction du ton. Ils se donnent des airs, ils font genre.

171Cette fiction du ton est des plus attendues dans le contexte d’une pièce de théâtre, cela ne suffit donc pas à faire détonner le propos à la façon du ton apocalyptique. Mais cela prend une tournure tout à fait différente lors de la diffusion de la pièce radiophonique La guerre des mondes. En effet, dans cette adaptation du roman du même titre de H. G. Wells, les comédiens de la troupe du Mercury Theatre, dirigés par Orson Welles, interprètent les différentes scènes non seulement comme s’ils faisaient référence à des faits réels (jusque là, rien d’anormal pour des acteurs), mais aussi comme si l’émission elle-même était un flash d’informations des plus sérieux. Il ne s’agit pas, comme d’habitude, d’une pièce de théâtre diffusée à la radio, mais d’une fiction d’émission de radio diffusée à la radio8787.Du moins, c’est le cas pour la première partie de l’émission, introduction exclue, comme le rappelle à juste titre Pierre Lagrange, dans La guerre des mondes a-t-elle eu lieu ?, Robert Laffont, Paris 2005. P.33..
172Mais ce n’est pas pour autant un canular, le but affiché n’étant pas de tromper les auditeurs. En effet, il est annoncé en introduction, et répété à deux reprises, que la pièce est une fiction. L’auditoire est prévenu : « La Columbia Broadcasting System et les émetteurs affiliés présentent Orson Welles et le Mercury Theatre dans la pièce radiophonique de Howard Koch inspirée du roman de H.G. Wells, la Guerre des mondes. »8888.Id., p.239. (Traduction complète de la pièce par Franck Straschitz). Pas de doute possible à l’écoute de cette phrase, pourtant, par la suite, il devient parfois difficile de savoir si l’on a affaire à une fiction ou à la réalité.
173En effet, les procédés de narration et le ton des acteurs imitent avec beaucoup de réalisme ce que l’on entend habituellement à la radio à l’époque. Des passages musicaux sont interrompus par des flashs spéciaux. Il y a un présentateur qui donne la parole à divers envoyés spéciaux dans différents lieux, exactement comme dans les émissions du soir de l’époque. Ce jeu d’acteur, bien qu’au service d’une narration, illustre bien ce que Jacques Derrida appelle la fiction du ton, à savoir le fait de mêler et de confondre deux façons de parler dans un même discours. Le jeu de l’acteur induit une confusion entre le ton d’un vrai animateur de radio et le ton de l’acteur jouant un personnage de fiction. Son ton, placé dans un contexte radiophonique, empêche de savoir clairement qui nous parle, surtout si on prend l’émission en cours de route.
174La fiction du ton opère donc une confusion entre « la voix de la raison et la voix de l’oracle »8989.Jacques Derrida, op. cit., p.32.. C’est-à-dire une non-distinction entre une analyse rationnelle, fondée sur des preuves vérifiables et une croyance aveugle et immédiate. Ce mélange a pour but de donner à l’oracle le caractère irréfutable des propositions de la raison. Avec ce procédé, une proposition irrationnelle peut ainsi obtenir le même crédit que n’importe quel propos scientifique. Outre le ton, plusieurs éléments du scénario de la pièce sont conçus pour donner une autorité et un crédit au discours : les analyses en direct d’un chercheur scientifique ; la lecture sans reformulation de dépêches d’agence de presse ; les envoyés spéciaux présents sur les lieux voyant de leurs propres yeux, en direct. Il y a là un savant mélange entre ce qui apparaît comme des données brutes et vérifiables d’une part, et d’autre part, des prises immédiates de connaissance, des expressions directes de révélation.
175J’aimerais poursuivre avec un parallèle entre ce que Jacques Derrida nous dit d’Emmanuel Kant et ce que nous entendons chez Orson Welles. Comme cité plus haut, ce qui intéresse Emmanuel Kant chez les mystagogues (selon Jacques Derrida), c’est qu’ils « font une scène »9090.Id., p.23. . Ils font une scène d’abord par eux-mêmes, en jouant tels des acteurs, le dévoilement incomplet d’un mystère. Mais, ils participent aussi, un peu malgré eux, à la pièce qu’Emmanuel Kant met en scène avec son pamphlet. Si l’auteur les met ainsi en scène, c’est dans un certain objectif, celui de passer un contrat pour réconcilier deux discours eschatologiques, l’un d’ordre philosophique (le sien), l’autre d’ordre esthétique et mystique (celui des mystagogues). Il semble bien qu’Orson Welles, par son travail de metteur en scène, soit devenu, à la manière d’Emmanuel Kant, responsable d’une scène de plus grande envergure qui oppose, elle aussi, deux discours eschatologiques présents dans la société américaine à la fin des années 1930.
176Avant de décrire cette scène, j’aimerais remarquer un fait. Le fait que la radio semble être le médium idéal pour confondre la voix de l’oracle et la voix de la raison. C’est même assez troublant de voir comme ce passage énigmatique écrit par Jacques Derrida devient clair si on imagine qu’il fait référence à la radio : « Pour changer de voix ou mimer l’intonation de l’autre, on doit pouvoir confondre ou induire une confusion entre deux voix, deux voix de l’autre et, nécessairement, de l’autre en soi. »9191.Id., p.30. N’est-ce pas exactement ce que l’on ressent quand on écoute la radio ? La voix de la radio, n’a-t-on pas l’impression qu’elle résonne en nous, et non pas qu’elle provient de l’objet radio ? La radio diffuse de façon immédiate des messages, elle nous fait entendre des voix. Ce ne serait donc pas surprenant qu’elle nous fasse croire à toutes sortes de choses improbables, comme une invasion martienne par exemple. Mais, attention, méfions-nous des idées reçues sur les médias, et des citations énigmatiques qui révèlent leur sens caché car, nous le verrons bientôt, ce qui apparaît spontanément comme un fait est essentiellement discutable.
2. La scène de la réception de la pièce
177En parlant de faits discutables, selon la presse écrite de l’époque, la pièce d’Orson Welles aurait créé des mouvements massifs de panique à travers les États-Unis. Les procédés mis en œuvre par Orson Welles auraient été si efficaces qu’ils auraient convaincu nombre d’auditeurs. Du moins, c’est ce qu’on peut lire le lendemain matin dans la presse. L’événement fait par exemple la une du New York Times avec ce titre : « Radio Listeners in Panic, Taking War Drama as Fact »9292.Auteur inconnu, cité d’après une copie de la une du New York Times du 31 octobre 1938, in The New York Times / l’intégrale des “unes” 1851-2009, éditions place des victoires, Paris 2009. « Les auditeurs dans la panique, ils ont pris une pièce sur la guerre pour la réalité » (traduction dans le texte de Pierre Lagrange.). L’article fait ensuite état de milliers de personnes qui auraient été victimes d’une vague d’hystérie collective. Les personnes fuyant la ville pour sauver leur peau auraient engendré des perturbations de la circulation tandis que de nombreux appels téléphoniques auraient submergé les systèmes de télécommunication. Les standards de la police et des radios locales auraient notamment été très sollicités par des habitants ne sachant pas comment garantir leur sécurité. L’article insiste donc sur l’ampleur de la panique, en opposition avec l’irresponsabilité d’Orson Welles qui l’a provoquée avec une simple émission de radio.

178Par ailleurs, le texte insinue aussi une certaine crédulité de la part des auditeurs. Comment ont-ils pu y croire bien qu’un message introductif exprimait clairement qu’il s’agissait d’une fiction ? La réponse : « les auditeurs, apparemment, ont manqué ou n’ont pas écouté l’introduction »9393.« The radio listeners, apparently, missed or did not listen to the introduction », ibid., traduction par moi-même.. En outre, les auditeurs auraient aussi ignoré trois autres messages insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une fiction.9494.« They ignored three additional announcements made during the broadcast emphasizing its fictional nature », ibid., traduction par moi-même. Pour couronner le tout, ils n’auraient pas été capables de lire, dans les journaux, le programme de la soirée qui annonçait bien une « pièce de théâtre ».9595.« They also failed to associate the program with the newspaper listing of the program, announced as « Today: 8:00-9:00—Play: H. G. Wells’s ‘War of the Worlds’— WABC » », ibid., traduction par moi-même.
179Voilà donc la description du New York Times : d’une part, Orson Welles est vivement critiqué parce que coupable d’avoir fait croire à la population qu’elle était en danger de mort ; d’autre part, l’audience elle-même semble aussi porter sa part de responsabilité, tant sa lucidité et son esprit critique ont fait défaut. Cette description faite par la presse écrite est en grande partie une exagération de ce qui s’est vraiment passé, c’est une mise en scène de l’événement, une construction sociologique. Cette mise en scène est analysée en détail par Pierre Lagrange, et elle m’intéresse parce qu’elle ressemble beaucoup à la scène précédente, qui opposait Emmanuel Kant aux mystagogues.
180Certaines des données reprises par la presse américaine sont vérifiables et vérifiées, par exemple l’augmentation du nombre d’appels dans la soirée attestée par les registres de la société ATC. Pierre Lagrange rapporte par exemple que l’augmentation a été de 39% dans les villes du nord du New Jersey, là où se déroulait la fiction.9696.Pierre Lagrange, op. cit., p.62. La presse écrite relaie cette information comme étant un signe de panique de la foule des auditeurs. Pourtant, il est difficile de savoir si ces appels témoignent d’une panique générale, ou simplement de l’usage intensif d’un moyen rationnel de vérification. Il n’est pas difficile d’imaginer que la majorité des appels étaient passés pour savoir s’il s’agissait ou non d’une fiction. Pourquoi la presse a-t-elle autant insisté sur la soi-disant panique du public ?
181Pierre Lagrange montre que la presse écrite a largement contribué à la construction du soi-disant vent de panique, le lendemain et les jours qui ont suivi, en multipliant le nombre d’articles, d’anecdotes et de témoignages en lien avec l’émission de radio. Les dépêches des agences de presse sont démultipliées par de multiples articles qui les relaient, eux-mêmes sont démultipliés par le nombre de lecteurs, puis les lecteurs s’échangent leurs histoires, et ainsi, en quelques jours seulement une rumeur est lancée, une légende prend forme. Et le contenu de cette rumeur n’est pas tant la panique que la crédulité du public qui a massivement cédé à la panique. Comme l’exprime franchement Pierre Lagrange : « Très vite, chaque Américain croit vivre au milieu d’une société dont tous les autres, excepté quelques proches, ont paniqué. »9797.Id., p.103.
182La scène que j’ai évoquée plus haut, dont Orson Welles est en partie responsable, oppose donc deux récits eschatologiques. Le premier semble irrationnel et improbable, il annonce l’invasion de la Terre par les Martiens. Le second est soi-disant rationnel, il accuse la crédulité de la foule par rapport au premier discours irrationnel. En effet, l’hystérie collective qu’aurait créée la pièce d’Orson Welles est souvent reprise pour soutenir des thèses rationalistes. Pierre Lagrange retrace rigoureusement la généalogie du mythe de cette panique. Parmi les nombreux exemples, le plus frappant revient à l’astrophysicien Evry Schatzman, fervent défenseur de la rationalité. En 1971, plus de 30 ans plus tard, dans un article intitulé « La formation rationaliste »9898.Cahiers rationalistes, n°285-286, p.235, cité par Pierre Lagrange, op. cit., le scientifique va jusqu’à affirmer ceci à propos de la pièce d’Orson Welles : « l’angoisse des New-Yorkais se trouvait nourrie par cette émission à un point tel qu’elle devenait insupportable et que la seule façon d’y échapper, au moins pour quelques-uns d’entre eux, était le suicide ». Il exprime aussi de façon assez dichotomique sa vision de la société : « Nous possédons tous un stock d’idées reçues : croyances, superstitions » puis il ajoute : « naturellement, pas nous les rationalistes ! ». On a donc, d’un côté, la foule hystérique et irrationnelle qui cède à la panique à la moindre annonce de fin du monde ; et, de l’autre côté, une élite de scientifiques rationalistes qui déplorent la crédulité engendrée par la culture de masse et la considère même comme une sérieuse menace à l’ordre social, un risque d’effondrement. Il va sans dire que ce discours sert les intérêts de l’élite soi-disant rationaliste. Pourtant, elle montre aussi clairement le comportement irrationnel des rationalistes, puisqu’ils utilisent, sous le coup la peur et sans le vérifier, un exemple falsifié.
183Mais certains discours moins extrêmes montrent aussi de quelle façon le problème a été posé à l’époque. Par exemple, la célèbre étude menée par le psychologue Hadley Cantril pour l’université de Princeton en 1940. Celle-ci part du postulat suivant : la panique a bel et bien eu lieu, et utilise ce cas d’étude pour comprendre l’influence psychologique de la radio sur l’homme moderne. L’étude désigne de façon explicite la panique comme la croyance en un discours eschatologique : « Pendant quelques heures insoutenables, des gens du Maine à la Californie pensèrent que des monstres hideux armés de rayons de la mort étaient en train de détruire toute résistance armée envoyée pour leur tenir tête ; et qu’il n’y avait absolument aucun moyen d’échapper au désastre ; et que la fin du monde était proche. »9999.Handley Cantril, The Invasion from Mars. A Study in the Psychology of Panic, Princeton University Press, Princeton 1940, cité par Pierre Lagrange, op. cit.. Il y a donc bien, pour l’auteur, une croyance populaire apocalyptique et irrationnelle qu’il s’agit de comprendre plus en détail. Les scientifiques doivent la comprendre parce qu’elle peut représenter une menace à l’ordre social.
184Cette opposition entre la rationalité des scientifiques et les croyances populaires de la foule est construite par les scientifiques eux-mêmes (comme nous le montre l’exemple un peu caricatural de Evry Schatzman) mais aussi par la presse écrite (comme nous l’avons vu avec l’article du New York Times). À ce propos, il est remarquable que cette opposition de tons soit déjà présente dans la pièce d’Orson Welles. En effet, le personnage de Pierson, joué par Orson Welles lui-même, est une caricature du scientifique qui ne croit en rien d’autre que la science, et dont l’assurance intimide les journalistes ; tandis que le personnage de Wilmuth incarne monsieur tout le monde, simplement un témoin intimidé par les reporters, et dont on coupe la parole sans gène. Au début de la pièce, le scientifique est sceptique et réfute spontanément toute hypothèse impliquant des Martiens. Puis, il fera figure d’autorité dans l’analyse des événements qui se déroulent. Au contraire, Wilmuth ne fait qu’une brève apparition, alors que c’est le principal témoin de l’atterrissage du vaisseau martien. Il a du mal à parler dans le micro des journalistes. Il raconte que, justement, il écoutait la radio quand cela s’est produit, mais qu’il s’endormait, parce que les propos du professeur Pierson étaient ennuyeux. La comparaison entre ces deux personnages semble aujourd’hui très ironique, et même prémonitoire, puisqu’elle caricature très justement ce qui va produire par la suite, à savoir que les experts scientifiques utiliseront l’exemple de la panique wellesienne comme une preuve de l’irrationalité des foules, tandis que les gens de la foule n’auront publiquement leur mot à dire qu’à condition que cela corrobore les thèses des soi-disant experts.
185Cette opposition des discours eschatologiques de la raison et de l’oracle est par la suite reprise et amplifiée. Mais les deux discours se valent dans leur rapport à la croyance. Pierre Lagrange le perçoit clairement de nos jours, et formule ainsi la symétrie qu’il observe : « Alors que la SF décrit la fin du monde sous le joug martien, les esprits scientifiques décrivent, eux, l’écroulement de la société à cause de la panique engendrée par cette croyance »100100.Pierre Lagrange, op. cit., p.176.. Il semble que les commentateurs de la panique irrationnelle aient mordu à l’hameçon d’Orson Welles. Ainsi, la culture savante laisse filtrer son penchant apocalyptique en accusant la culture populaire. La seule vraie différence repose sur une construction sociale décrite ainsi : « Mais, recouvertes d’un vernis sociologique [au sens de scientifique, crédité], les fins du monde rationalistes paraissent scientifiques. »101101.Ibid. Ainsi, le sociologue inclut dès le départ sa propre science au sein des illusions rationalistes. Elle peut donner du crédit à des discours qui reposent sur des croyances.
186Le « vernis sociologique », c’est une façon de nommer le ton apocalyptique dans le cadre d’une étude sociologique, c’est-à-dire le procédé linguistique, inscrit et interprété par des logiques sociales, qui confond la raison et l’oracle, la vérité et les croyances. Ce qui fait passer pour rationnel ce qui ne l’est pas. Cependant, puisque ces fins du monde apparemment scientifiques sont « recouvertes », il s’agit de les découvrir, de révéler que celles-ci ne sont que des croyances. Mais en révélant cela, ne devenons-nous pas justement l’expert scientifique que nous dénonçons ? Ne serions-nous pas en train de révéler que tout n’est que croyance — à l’exception de cette vérité-ci ? Si tel semble être le cas, alors comment trouver une issue à cette situation qui n’est pas sans rappeler celle de Jacques Derrida dans tout son ouvrage et celle de Jean Baudrillard à la fin de sa société de consommation ?
3.Une clôture scientifiquement possible pour cette scène
187Il s’agit de trouver une issue satisfaisante à ce début de réflexion afin de la rendre cohérente avec elle-même. C’est-à-dire de trouver une certaine conception de l’activité de recherche qui inclue de la même façon l’objet d’étude et le chercheur lui-même. Une forme d’analyse critique qui puisse devenir entièrement réflexive, dans le sens où l’auteur et son objet d’étude y seraient toujours autant exposés. Les énoncés critiques pourraient donc subir leur propre critique, sans pour autant s’annihiler. Il s’agirait d’un mode de discours qui resterait pertinent même dans son autocritique. La question est donc la suivante : comment Pierre Lagrange peut-il critiquer l’opposition superficielle entre les savoirs scientifiques et les croyances populaires, alors qu’apparemment son texte fait lui-même partie de ce qu’il nomme la « culture savante » ?
188Dans un article publié en 1983, le sociologue, anthropologue et philosophe Bruno Latour utilise l’expression « le Grand Partage » pour nommer cette distinction binaire, cette séparation nette entre ce qui est scientifique et rationnel d’une part, et ce qui est de l’ordre des croyances et de l’irrationnel d’autre part. Comme nous l’avons vu avec la réception de la pièce d’Orson Welles, cette idée du Grand Partage a un pouvoir de séduction des plus surprenants : elle fait perdre la raison au rationalistes. En effet, cette division est acceptée a priori, c’est-à-dire comme une croyance, par de nombreux scientifiques. La primauté de la rationalité serait donc fondée sur une pure croyance.
189Le projet de l’anthropologie des sciences, dont Bruno Latour est un important contributeur102102.Notamment avec son ouvrage Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts (traduit en français par La Vie de laboratoire : la Production des faits scientifiques, 1988) écrit avec Steve Woolgar et publié en 1979., remet en question ce fondement et pourrait bien nous fournir une conception satisfaisante de discours scientifique et (auto)critique.
190Il n’y a aucune raison de croire à cette grande division. Pour éclaircir la situation, l’auteur propose d’étudier les scientifiques avec la même méthode et le même regard que lorsque l’on étudie une société étrangère et lointaine. Pour cela, il faut procéder à une analyse « symétrique »103103.Bruno Latour, « Comment redistribuer le Grand Partage ? », in Revue de Synthèse, n°110, Avril/Juin, pp.203-236, 1983. Consulté en ligne le 24 février 2016. P.207.. Il ne faut pas vérifier l’exactitude du discours étudié en fonction d’un système logique postulé a priori. Il ne s’agit pas de noter les écarts par rapport à une conception dite rationnelle. Au contraire, il faut chercher à comprendre en détail le système logique dans lequel le discours est inséré. Que l’on s’intéresse à une société apparemment primitive ou au milieu des chercheurs scientifiques, il n’y a pas une logique unique et absolue, mais seulement des logiques sociales et contextuelles. Ainsi, « La logique qui n’était jusqu’ici qu’influencée par la société est devenue une sociologique. »104104.Id., p.211.
191Cette méthode anthropologique se propose d’expliquer l’essor des sciences et des techniques modernes par des mécanismes sociologiques. En effet, il n’y a aucune raison pour que les sociétés modernes échappent à ces explications historiques et sociales. Au lieu de se réfugier derrière une téléologie de la raison légitimant la supériorité des sociétés occidentales modernes, il vaut mieux étudier les discours et les actions des scientifiques, afin de comprendre ce qui leur confère une certaine force dans les rapports sociaux. Car il reste indubitable, malgré ce revirement symétrique, que la pensée dite rationnelle est plus forte que les autres. Les discours, lorsqu’ils sont jugés comme rationnels, accèdent à une force extraordinaire. À l’inverse, lorsqu’une proposition prétendant à la validité scientifique est rejetée par le milieu des chercheurs, elle est discréditée et perd toute sa force. Elle est comme condamnée. L’auteur parle carrément d’un « tribunal de la raison » dans lequel « des jugements sont rendus » et où l’on « n’empêche pas la sentence de tomber ».105105.Id., p.217. Bruno Latour ne réfute donc pas ce qu’Emmanuel Kant appelle la « police au royaume des sciences »106106.Emmanuel Kant, op. cit., cité par Jacques Derrida, op. cit., p.31., c’est-à-dire une instance symbolique qui réprime les discours faussement scientifiques. Mais, il affirme que la justice qui est rendue ne doit pas être vue comme l’application indiscutable de principes a priori. Le seul principe est que tout énoncé peut prétendre à l’accréditation des sciences rationnelles. Ensuite, ce sont des mécanismes sociaux qui rendent le jugement, et le verdict ne tient pas lieu de vérité absolue. Que les découvertes de la physique soient accréditées dépend avant tout de logiques sociales.
192En effet, le jugement rationnel est exprimé progressivement par différents acteurs de la société : amis, compères, personnalités, institutions, médias, etc. Tous ces avis, en bout de course, font le jugement. Bruno Latour indique que ce processus de jugement est un cas particulier de la construction sociale des « faits »107107.Bruno Latour, op. cit., p.218.. Les faits sont des énoncés qui ne posent aucun problème. Ce genre de phrase qui passe comme une lettre à la poste en toute circonstance. Typiquement, l’hystérie collective engendrée par Orson Welles a pendant longtemps était considérée comme un fait. C’était un « précédent » comme le dit Pierre Lagrange dans son introduction, ou bien un « prémisse à des raisonnements » comme le dit plus généralement Bruno Latour.108108.Ibid. Un énoncé indubitable duquel on part.
193Pour qu’un énoncé soit considéré comme un fait, il faut donc qu’il soit jugé par la société en tant que tel. Il doit être entendu, répété et accepté en tant qu’évidence par la majorité de gens, de sorte qu’il ne présente plus aucune résistance lors des discussions. Comme les sources de désaccord sont nombreuses dans la société, ce que Bruno Latour appelle des faits sont en majorité des compromis, des énoncés reformulés suffisamment de fois pour satisfaire tout le monde. La plupart du temps, ils se conforment à tous les points de vue. On pourrait dire que c’est un lieu commun, par opposition à une opinion. Celui qui ne rapporte que des faits n’exprime pas vraiment son opinion.
194Dans ce cadre de pensée, le fait scientifique est un cas particulier d’une grande rareté qui apparaît comme un énoncé radicalement nouveau, strictement authentique et dont l’auteur est reconnu publiquement. Ces trois caractéristiques en font quelque chose de très difficile à produire et donc rare. Premièrement, la nouveauté de l’énoncé fait qu’il est plus difficile d’y croire. Quelque chose de radicalement nouveau éveille les soupçons. Pourquoi ne le savait-on pas déjà ? Deuxièmement, l’authenticité de l’énoncé suppose que personne ne le reformule, alors même qu’il est censé satisfaire tous les points de vue. Tout le monde doit être convaincu de ce qu’il entend et répète sans jamais en modifier la moindre tournure. Troisièmement, pour que l’auteur soit reconnu, la proposition doit toujours être accompagnée d’une autre proposition qui la rattache à celui-ci. Et cette indication de l’auteur doit assurer les mêmes garanties d’authenticité que la première. Bruno Latour, dont le projet est de dépasser l’idée du Grand Partage, ne distingue pas les faits en fonction des catégories scientifique et non-scientifique. Il les dispose plutôt le long d’une échelle de « dureté »109109.Id., p.220.. Les faits scientifiques sont des faits très durs, tandis que les rumeurs sont beaucoup plus molles. (On ne sait pas d’où elles viennent, elles ne changent pas radicalement notre façon de penser et elles ne cessent d’être reformulées.) Il se trouve que plus un fait est dur plus il a de pouvoir dans un débat, plus il pourra modifier les logiques sociales en place.
195J’aimerais ici attirer l’attention sur l’étonnante complémentarité entre les difficultés de produire des faits durs exposées par Bruno Latour et le procédé du ton apocalyptique décrit par Jacques Derrida. Il semble en effet que le ton apocalyptique soit une sorte de formulation magique qui transforme n’importe quel énoncé en un fait dur comme le roc. Bien sûr, ce n’est pas une vraie transformation, c’est un simple sortilège qui trompe l’audience un certain temps, mais la correspondance est bluffante. Vérifions, point par point, comment le ton apocalyptique répond aux exigences de dureté des faits scientifiques.
196Pour ce qui est de l’exigence de nouveauté, nous avons vu que le ton apocalyptique était intimement lié au mystère, et le mystère est justement un réservoir inépuisable de nouveauté. Du moment que l’on ne le dévoile pas complètement, il y a toujours un moyen de raviver l’intérêt de l’audience par une nouvelle révélation. Ceux qui ont suivi la série télévisée Lost : les disparus ont fait l’expérience de ce mécanisme. Un groupe de naufragés est coincé sur une île mystérieuse. L’île est si mystérieuse qu’elle permettra aux scénaristes d’écrire 121 épisodes de 42 minutes, chacun livrant son lot de nouvelles révélations. La foultitude d’événements nouveaux et inattendus est rendue possible par une astuce simple mais efficace : le grand mystère, celui de l’île, n’est jamais complètement dévoilé (sauf à la fin). Le pouvoir de séduction mystagogique est donc le moyen parfait pour palier à un manque de nouveauté dans la production d’un fait dur.
197En ce qui concerne l’exigence d’authenticité de l’énoncé, elle est elle aussi contournée par le ton apocalyptique. Par exemple, le texte de l’Apocalypse de Jean rend explicite sa propre authenticité avec ce passage de l’épilogue : « Je l’atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre : Si quelqu’un y ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. / Et si quelqu’un retranche aux paroles de ce livre prophétique, / Dieu retranchera sa part de l’arbre de vie et de la cité sainte / qui sont décrits dans ce livre. » (XXII, 18-19). Ces menaces, écrites ou retranscrites par l’auteur du texte, semblent être un moyen d’éviter qu’il soit modifié et d’assurer ainsi son authenticité. Pourtant, rien ne nous assure que le texte n’ait jamais été modifié. Si tel était le cas, ce serait en fait une exception incroyable parmi les textes bibliques. Comme nous le rappelle Bruno Latour, la force de l’évangile réside justement dans la capacité des textes bibliques à être réappropriés par chaque communauté convertie. Paradoxalement, la fidélité du prédicateur s’exprime par sa capacité à modifier les textes. Les textes et les croyants ne sont fidèles que dans la mesure où ils transforment les écritures saintes en quelque chose de nouveau qui leur est propre. Concrètement, ces actes d’appropriation fidèle peuvent être « un miracle, un admirable sermon, [...] , une enluminure éblouissante, ou tout simplement de nouveaux éléments ajoutés au récit »110110.Id., p.233.. Dans cette logique de reformulation continue du texte biblique dans des actes et des discours, la menace écrite à la fin de l’Apocalypse de Jean apparaît bien comme une façon de durcir le propos. Ce texte là ne doit pas être changé et ne l’a d’ailleurs jamais été. Il s’agit à la fois d’une menace et d’une garantie. Si j’ai peur de la menace et ne change rien du texte, alors les autres ont sûrement fait pareil avant moi. De la même façon, dans La guerre des mondes d’Orson Welles, le présentateur annonce qu’il lit des dépêches, sans aucune reformulation. Cette annonce est censée garantir l’authenticité du message, pourtant nous n’avons aucune preuve de l’existence même de ces dépêches. Le ton apocalyptique permet donc de faire passer pour authentique un propos essentiellement protéiforme.
198Enfin, concernant la reconnaissance authentique de l’auteur, l’Apocalypse de Jean est encore un très bon exemple, puisque tout le monde sait que le texte est de Jean de Patmos — c’est écrit dans les premières lignes — pourtant aucun historien ne parvient à déterminer qui était cet homme. Derrière l’apparente traçabilité du discours exprimée par l’introduction111111.Citée plus haut, paragraphe 145., il y a en fait une situation d’énonciation inextricable. Jean semble en effet écrire sous la dictée de Jésus, lui-même exprimant la parole de Dieu. Or, si Jean n’a rien ajouté à ce que Jésus a dicté, comment peut-il présenter en introduction cette dictée qui n’a manifestement pas encore commencée ? Par ailleurs, cette introduction évoque aussi un ange, envoyé de Dieu qui semble avoir attesté la vision de Jean avant même qu’il l’ait eue… À cette situation compliquée s’ajoutent les différentes adresses du message : « Heureux celui qui lit » (I, 3) ; « aux sept Églises qui sont en Asie » (I, 4) et Jean lui-même puisque c’est Jésus qui lui dicte le tout. Ces renvois enchaînés de narrateur en narrateur créent une forme de discours rapporté qui semble tourner en boucle112112.À propos de cette interprétation de la situation d’énonciation dans l’Apocalypse de Jean, voir Jacques Derrida, op. cit., pp.72-77. . La complexité de la situation d’énonciation donne l’impression que ces paroles ont réellement été prononcées. Le procédé utilisé par la pièce d’Orson Welles est similaire : la situation d’énonciation est toujours complexe puisqu’elle fait intervenir les présentateurs, les citations de dépêches, les envoyés spéciaux, ainsi que les divers témoins. Tous ces narrateurs racontent ce qu’ils voient ou rapportent des discours. Ils parlent à la fois entre eux et aux auditeurs. Cette multitude d’auteurs rend plus crédible les événements rapportés, sans qu’on ait besoin de savoir exactement qui est en train de parler. Le ton apocalyptique permet donc de donner l’impression qu’un énoncé provient bel et bien d’un auteur identifiable alors que sa provenance est des plus confuses.
199Dans sa version archétypale, celle de l’Apocalypse de Jean, ou dans une expression plus récente, comme celle de La guerre des mondes, le ton apocalyptique est une façon de parler, une technique rhétorique et linguistique qui durcit l’énoncé prononcé. Cette dureté, caractérisée par l’impression de nouveauté et d’authenticité du texte et de l’auteur, donne de la force à l’énoncé pour transformer la société.
200Dans La guerre des mondes, ce procédé apparaît comme une manière de synthétiser des faits scientifiques. Mais son influence est plus étendue que le domaine scientifique, puisque l’on trouve son origine dans des discours évangélistes. La méthode de Bruno Latour semble ici pertinente : la symétrie dans l’étude des discours, qu’ils soient d’ordre religieux ou scientifique permet de mieux saisir l’action du ton apocalyptique. En outre, il faut aussi étudier l’asymétrie des rapports de forces entre les différents discours. Ainsi, le ton apocalyptique, dans sa version contemporaine, travaille davantage dans le sens du discours scientifique.